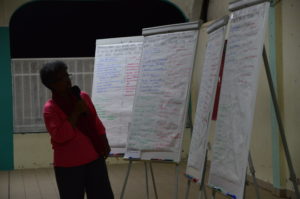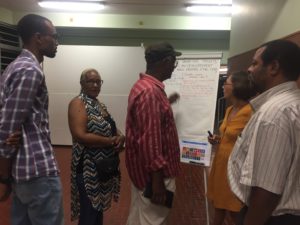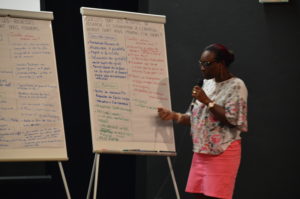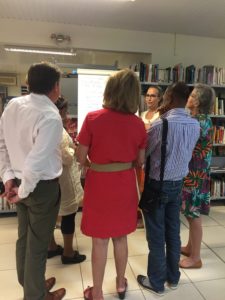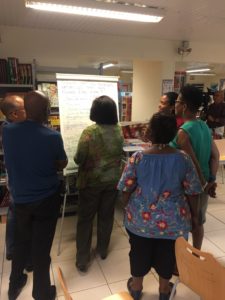Réunion citoyenne pour le titre mondial de Réserve de Biosphère, ville du Gros-Morne
Vendredi 13 Septembre, la commune du Gros-Morne nous accueillait pour la 32ème réunion de présentation et de co-construction du dossier de candidature de la Martinique au titre de Réserve de Biosphère. Commune centrale, entourée de sept autres communes, elle recèle de nombreuses richesses et notamment la plus grande rivière de Martinique : la Lézarde.
M. Raymond Baybaud et Mme Yolande Burac, membres du conseil municipal, ont ouvert cette réunion publique en adressant leurs remerciements aux habitants présents ainsi qu’aux membres de l’association. Puis Mme Nathalie de Pompignan, Présidente de l’association, a remercié l’assemblée et leur a présenté le projet de Réserve de Biosphère et les avantages que ce titre peut apporter à la Martinique. « Valoriser et fédérer étant les maitres mots de ce projet ambitieux, c’est ensemble que nous nous engageons pour un bel avenir commun. »
M. le Maire, M. Gilbert Couturier, a pris la parole à son tour pour remercier les administrés. Il a témoigné de l’engagement de la commune du Gros-Morne dans le projet de Réserve de Biosphère. Le Gros-Morne est fort de richesses naturelles et d’histoire, qu’il est important à ses yeux de connaitre et valoriser.
Les participants se sont ensuite répartis entre les quatre ateliers participatifs, reprenant les thèmes abordés au sein du dossier de candidature : les richesses naturelles ; les richesses culturelles ; les savoir-faire, produits et activités liés au développement durable ; les activités de recherche et d’éducation à l’environnement. Pour chacune de ces thématiques, ils ont abordé ce dont ils sont fiers dans leur commune et en Martinique, ainsi que des projets qu’ils aimeraient voir émerger sur le territoire.
Richesses naturelles – Au Gros-Morne, les habitants apprécient les multiples rivières, les forêts, la qualité du sol et le climat frais. Ils sont fiers de la faune et de la flore, en particulier de l’arbre Mao bleu ainsi que du plus petit serpent du monde, découvert en 2016 : le « serpent fil » ou encore « serpent spaghetti » (Tetracheilostoma nov) nommé localement le couresse ou ti sèpan tè en créole.
En Martinique, la Montagne Pelée, les Pitons et les Mornes sont des incontournables, tout comme le Rocher du Diamant, le Tombolo de Sainte-Marie, la Savane des Pétrifications et les Salines. « Magnifiques » fut d’ailleurs l’adjectif attribué par l’ambassadrice du groupe à toutes ces richesses naturelles. Les cours d’eau, les forêts, les plages, la mangrove, les îlets, la faune et la flore en font également partie. Tout particulièrement les arbres remarquables, tel que le zamana, le figuier maudit, et le gommier (blanc et rouge), mais aussi les espèces endémiques comme le trigonocéphale, la matoutou falaise, le moqueur à gorge blanche, le carouge ou l’iguane des petites Antilles et le colibri à tête bleue (Martinique et Dominique).
Malheureusement, ces joyaux naturels sont menacés par nos activités, et selon les habitants spécifiquement par l’usage de pesticides, les rejets industriels, les eaux usées, les déchets domestiques et sauvages, les VHU, etc. Les risques naturels sont également identifiés comme menaces, tout comme le changement climatique. Sans oublier la problématique des espèces envahissantes, qui s’imposent face aux espèces endémiques. L’exemple du chancre citrique a été cité, provoqué par une bactérie s’attaquant aux agrumes, ainsi que celui de l’escargot géant d’Afrique. La fusariose, causée par un champignon que l’on retrouve sur certains fruits, en Colombie, a également été nommée car elle pourrait représenter un danger à l’importation de ces produits.
Richesses culturelles – Les habitants ont cité l’Eglise du Gros-Morne, les deux fontaines, le jardin, et le parc des loisirs qui, en forme d’arène, permet la réalisation de manifestations. Ils ont également désigné l’habitation Saint-Etienne et son jardin, le moulin Marie-Calixte et la tombe du Commandant Dessaint, qui commandait la place du Gros-Morne lorsque la commune était capitale de l’île. Une grande importance est aussi attribuée à la Croix mission de 1925, ainsi qu’aux artistes Gros-Mornais (écrivains, réalisateurs, musiciens, conteurs,…) tel que la réalisatrice Euzhan Palcy, dont le film « Rue Cases-Nègres » a été un grand succès. On retrouve également le bakoua, la fabrication et les initiations au tambour. En outre, l’association Lakou A a été saluée pour ses moments culturels mettant en valeur les traditions martiniquaises, comme le damier. Enfin le sport au Gros-Morne a été identifié, tout particulièrement le handball féminin.
En Martinique, les participants sont fiers de leur identité culturelle. Ils ont nommé le bèlè et le damier, la yole et le gommier, le carnaval, les cantiques de noël, et la gastronomie (matoutou, trempage, pâté en pot, …). Le créole et les lasotès sont également propres à la Martinique. Enfin, les divers musées et structures d’accueil du public (la Pagerie, le Musée de la banane, le Musée de la canne, la Savane des esclaves, …) et la ville de Saint-Pierre ont été mentionnés, ainsi que les nombreux écrivains et artistes. Les participants souhaiteraient alors pouvoir mieux accueillir les visiteurs, et proposent ainsi de créer un guide touristique, de créer des supports multimédias pour la communication, développer des points d’accueil touristique (type office du tourisme), créer des visites thématiques, et développer l’hébergement chez l’habitant (gîtes, …). M. le Maire a d’ailleurs rappelé que les premiers gîtes martiniquais ont vu le jour au Gros-Morne. De plus, les participants ont suggéré de mettre en avant le créole dans la communication, de favoriser l’innovation pour attirer les jeunes, et ont mis l’accent sur l’importance de la transmission des savoirs en favorisant le lien intergénérationnel.
Savoir-faire, produits et activités liés au développement durable – Au Gros-Morne, les habitants ont identifié l’élevage et l’agriculture (banane, ananas, goyave). Mais aussi la transformation de produits agricoles locaux par l’usine DENEL, la fabrication de rhum à l’habitation Saint-Etienne, la production de manioc au moulin hydroélectrique, les plantations de fleurs locales à la maison de l’anthurium, et la vannerie de Rivière Lézarde. Le jardin du Gros-Morne a également été cité, pour sa plantothèque et l’ethnopharmacologie, ainsi que le jardin de Théonie, premier gite rural labellisé « Clef Verte » à la Martinique, illustrant ainsi son engagement pour la protection de l’environnement. Et enfin, le transport urbain et le tri sélectif. Il a également été notifié qu’auparavant, la culture de riz était présente. Un agriculteur l’expérimente à Ducos depuis 5 ans, ce qui pourrait donc être reconduit dans d’autres localités, comme au Bois Lézard du Gros-Morne.
En Martinique, les participants sont fiers du rhum, de l’artisanat, des plantes médicinales, des randonnées et des activités nautiques. Ils ont émis de nombreuses idées d’actions à entreprendre pour continuer dans une voie de développement durable. Ils proposent de réhabiliter et revaloriser les sites naturels (le saut Argis, le saut Potier, les sources thermales, …), de valoriser les savoir-faire ancestraux et les produits locaux dans les constructions traditionnelles, comme le vetiver, de généraliser la récupération d’eau de pluie, de réintroduire des espèces natives dans les rivières, et d’éradiquer les VHU. En outre, ils souhaiteraient développer la pharmacopée naturelle, propager l’agriculture biologique pour toutes les cultures locales et valoriser la culture de cacao et de café. Il leur parait d’ailleurs particulièrement important de soutenir l’association « les cols verts » qui prône l’agriculture biologique.
Activités de recherche et d’éducation à l’environnement – Les Gros-Mornais ont souhaité mettre en avant les activités de lasotè et koudmen, ainsi que les chantiers d’insertion et les jardins au sein des écoles et du collège. En Martinique, ils ont identifié les nettoyages de plages et rivières, la répertorisation des sources et rivières, et le refleurissement opéré par les communes. Ils souhaiteraient alors que des actions de sensibilisation orientées vers la protection des eaux (rivière, mer, mangrove) soient mises en place, notamment pour protéger les différentes espèces de poissons. Par exemple, sensibiliser à la pollution des eaux afin d’éviter les divers rejets et déchets. Il s’agit de responsabiliser l’ensemble des individus. Il leur semble également primordial d’informer la population sur les actions à ne plus reproduire et d’éliminer les pesticides. En sus, ils suggèrent de développer de nouvelles techniques pour les cultures sur les sols contenant du chlordécone, mais surtout assainir les sols. La recherche sur les sargasses parait également essentielle en Martinique, ainsi que sur le réchauffement climatique, tout particulièrement sur les problématiques liées à l’érosion côtière.
Pour conclure, M. Jean-Paul Jouanelle, vice-président de l’association, a tenu à encourager la sollicitation des Martiniquais ayant une vie professionnelle à l’extérieur et mettant leurs talents au service de leur pays, à l’image de Nathalie de Pompignan, experte UNESCO, aujourd’hui présidente de notre association qui porte le projet de candidature de la Martinique au titre de Réserve de Biosphère.
Les membres de l’association et ceux de la mairie ont remercié chaleureusement les habitants présents pour leur excellente participation. Et M. le Maire s’est attaché à souligner les nombreuses richesses présentes au Gros-Morne, mais également la beauté de la Martinique, ainsi que son envie d’agir pour sa valorisation. « On est en mesure de construire des choses ensemble, au-delà des désaccords ».